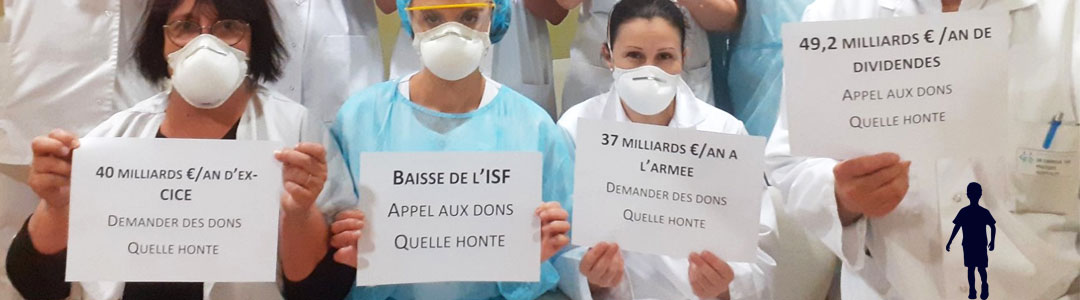Il nous est difficile de comprendre ce qu’est l’ « État » parce que les catégories que nous utilisons pour penser l’ « État » sont généralement produites et légitimées au nom même de l’«État». Par exemple, ce sont les discours émis au nom de l’ « État » qui définissent ce que sont une fonction régalienne, un territoire national ou une frontière, une administration publique, une prérogative de la puissance publique… Autant de notions qui servent en retour à caractériser ce qu’est l’ « État ».
Pour essayer de rompre avec cette pensée circulaire de l’ « État » parlant de l’ « État », Pierre Bourdieu propose d’utiliser le concept de « capital ».
Penser la genèse de l’État
L’une des conditions majeures pour qu’une institution sociale, quelle qu’elle soit (croyance, dogme, rapport social, groupe spécialisé…), puisse s’imposer dans une société est qu’elle fasse oublier qu’elle résulte d’une longue série d’actes d’institution. Il faut qu’elle se présente sous les apparences du naturel, du « cela va de soi » ou du « il en a toujours été et en sera toujours ainsi ».
La reconstruction de la genèse d’une institution constitue donc la méthode la plus puissante pour remettre en question son caractère «naturel» et pour réactiver d’autres possibilités.
Ce que propose Pierre Bourdieu, c’est un modèle de l’émergence de l’institution étatique, à travers la reconstruction du processus de concentration du « capital étatique« .
La construction de ce que nous appelons l’« État » correspond à un processus de concentration de différentes formes de capitaux : capital de force physique, capital économique, capital informationnel et culturel, capital symbolique. De cette concentration résulte la formation d’un capital spécifiquement étatique.
Et la détention de ce capital étatique par des agents sociaux (groupes, individus) leur confère un pouvoir sur les autres formes de capitaux et sur leurs détenteurs. Autrement dit, les agents qui détiennent du capital étatique sont en mesure d’influencer les actions des agents qui ne détiennent que du capital économique (entrepreneurs par exemple) ou du capital culturel (artistes, enseignants…).
Capital armé et capital financier
Dans le processus de formation du capital étatique, les mouvements de concentration des différentes formes de capitaux sont interdépendants.
La concentration du capital de force physique correspond à une séparation progressive entre le monde social ordinaire et des groupements spécialisés comme l’armée ou la police. Au terme de cette séparation, seules les institutions mandatées, centralisées et disciplinées sont autorisées à exercer la violence physique. En Occident, cette concentration est advenue par dépossession progressive des concurrents intérieurs (troupes de la noblesse…), au bénéfice de la maison royale.
La concentration du capital de force coercitive est directement liée à la concentration de capital économique. Celle-ci résulte de l’instauration d’une fiscalité efficiente. Lorsqu’elle apparaît, en France, à la fin du 12ème siècle, c’est pour financer l’accroissement des dépenses de guerre de la maison royale.
L’usage des ressources fiscales et d’abord patrimonial. Il combine les prélèvements sans contrepartie pour la guerre et la redistribution sous forme de dons et de largesses, destinés à accroître le capital symbolique du roi. Petit à petit, il se transforme en un usage bureaucratique, prenant la forme de « dépenses publiques ». Ce mouvement de transformation s’opère en même temps que le passage de l’État dynastique à l’État « impersonnel » moderne.
L’institution de l’impôt universel et le développement de la force physique coercitive sont dans un rapport de causalité circulaire. L’impôt est indispensable pour financer la force armée qui est nécessaire pour imposer la fiscalité par la contrainte.
Capital informationnel et culturel
La concentration du capital économique grâce à la fiscalité unifiée va de pair avec la concentration du capital informationnel. L’administration royale commence à concentrer l’information sur les ressources du royaume, par le recensement, la statistique, la comptabilité, la cartographie et l’archivage.
Dans un même mouvement, la maison royale puis les gouvernements républicains contribuent à l’unification du marché culturel. Ils unifient les codes, les lois, la langue, le système des poids et des mesures. Ils systématisent les classements de la population (âge, sexe…), les procédures bureaucratiques et scolaires. Ils imposent des formes de pensée et des principes de vision et de division communs : le bien et le mal, le permis et l’interdit, la définition de l’identité nationale, l’orthographe…
Capital de reconnaissance et de légitimité
Cependant, la concentration des différentes formes de capitaux ne va pas sans un minimum de reconnaissance et de légitimité. Par exemple, l’imposition est d’abord perçue comme un racket, y résister est considérer comme la défense moralement légitime des droits de la famille.
La construction progressive de la légitimité transforme cette perception. La population finit par voir l’impôt comme un tribut qui est nécessaire aux besoins d’un destinataire qui transcende la personne du roi, l’« État », la « nation »…
Pour opérer cette légitimation, il faut que le corps des agents chargés du recouvrement de l’impôt ne le détourne pas à son profit et qu’il soit identifié avec la dignité du pouvoir. L’émergence d’une forme de nationalisme et la construction de la nation comme territoire unitaire à défendre favorisent aussi le développement de la reconnaissance de la légitimité de l’impôt.
Capital juridique et symbolique
Toutes ces opérations renvoient à la concentration en capital symbolique. Le capital symbolique c’est n’importe quelle espèce de propriété lorsqu’elle est reconnue par les agents sociaux et qu’ils sont prêts à obéir à son détenteur. le capital symbolique peut provenir de la détention d’une autre forme de capital. Selon les contextes, les agents se font obéir parce qu’ils détiennent du capital économique (sous forme d’argents, de moyens de production…), du capital culturel (sous forme de titres, de diplômes…) ou encore du capital social (sous formes de réseaux).
Le capital juridique est par excellence une forme objectivée et codifiée de capital symbolique. Il suit une logique qui lui est propre est qui est indépendante de l’accumulation des autres formes de capitaux. A partir de la fin du 12ème siècle, la juridiction royale s’insinue peu à peu dans la société entière. La justice royale se substitue progressivement aux tribunaux des seigneurs et de l’Église. L’ordonnance de 1670 clôt ce processus de concentration.
Lire aussi « L’État entre reproductions domestique et scolaire du pouvoir »
Notons que la construction des structures juridiques et administratives va de pair avec la construction d’un corps de juristes qui contrôle rigoureusement sa propre reproduction.
Cette concentration du capital juridique est un aspect central d’un processus plus large de concentration symbolique sous différentes formes. Elle est au fondement du pouvoir d’imposer et d’inculquer aux agents sociaux ordinaires, des principes de vision et de compréhension du monde qui sont conformes à la reproduction de l’autorité.
Pouvoir de nomination
Sur ce sujet lire « Magie sociale : Jojo et les imposteurs »
Parmi ces pouvoirs, celui de nommer tient une place centrale. La nomination est un acte mystérieux qui obéit à une logique proche de celle de la magie décrite par Marcel Mauss.
La nomination et le certificat (de propriété, de mariage, d’invalidité…) appartiennent à la classe des actes ou des discours officiels qui sont symboliquement efficients parce qu’ils sont accomplis par des personnages autorisés.
Le roi avec son pouvoir d’anoblir et l’institution de la noblesse de robe qui doit sa position à son capital culturel (juridique, administratif…) sont très proches de la logique des nominations « étatiques » et de la sanction du parcours scolaire par les titres.
Lire un article sur les Actes d’État
Mais, entre les deux, on est passé d’un capital symbolique diffus, fondé sur la reconnaissance collective de la personne du roi, à un capital symbolique qui est objectivé, codifié, délégué et garanti par l’État bureaucratisé. Les titres, verdicts, enregistrements officiels, constats, procès-verbaux, actes de l’état civil ou de vente ont la capacité de créer de la réalité objective (des personnes sont emprisonnées, deviennent propriétaires ou sont mariées…) parce que ces actes sont accomplis par des agents investis au nom de l’État.
Capital d’universalisation
La construction d’un monopole étatique de la violence physique et symbolique engendre inévitablement la construction d’un champ de luttes pour la captation de ce monopole et des avantages qu’il procure. Selon la thèse développée par Pierre Bourdieu, la monopolisation des ressources universelles ne peut être obtenue qu’en échange d’une soumission, au moins apparente, à « l’universel ».
En effet, le long processus de construction de la vision de l’État comme lieu de l’intérêt général et de l’universalité impose aux fonctionnaires de se référer aux valeurs de neutralité et de dévouement désintéressé au bien public. Cette référence obligée a des effets bien réels.
Les personnages officiels doivent en permanence sacrifier leurs points de vue particuliers ou égoïstes au bénéfice du point de vue universel ou, au moins, essayer de constituer leurs points de vue particuliers en point de vue universel.
L’universel bénéficie d’une reconnaissance universelle. Le sacrifice des intérêts égoïstes au profit de l’universel est reconnu universellement comme légitime. Pour Pierre Bourdieu, cela implique que les agents gagnent des profits symboliques et matériels lorsqu’ils agissent ou font mine d’agir dans le sens de l’universalisation.
Le champ bureaucratique est celui qui demande avec le plus de force la soumission à l’universel. Il est donc particulièrement favorable à l’obtention de profits d’universalisation. De ce fait, « le profit d’universalisation est sans doute un des moteurs historiques du progrès de l’universel ». Et donc, même si nous ne pouvons pas ignorer tous les manquements et les cas de détournements du service public à des fins personnelles, nous ne pouvons pas pour autant nier qu’il y a dans les consciences, en général, une progression de la norme qui enjoint aux agents de L’État de sacrifier leurs intérêts personnels au profit de l’intérêt général.
Gilles Sarter