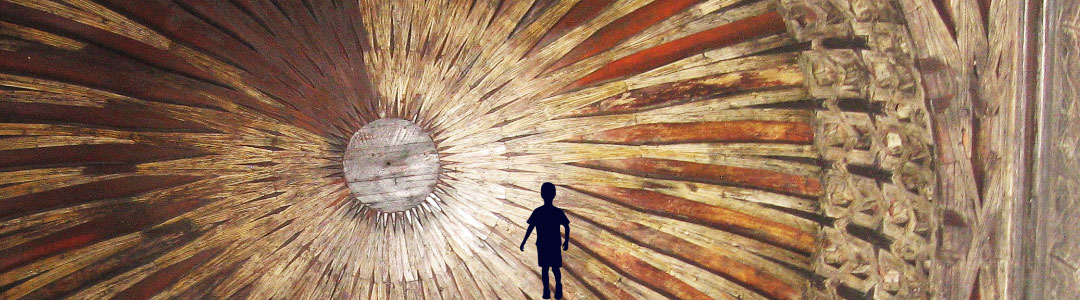Le néolibéralisme doit être compris comme un projet de dé-démocratisation.
Wendy Brown, Undoing the Demos, Zone Books, 2015
L’argument de Wendy Brown n’est pas tellement que les finances ou les grandes entreprises dominent les institutions politiques. Ni que le gouvernement des riches a remplacé le gouvernement du peuple. Son idée est plutôt que la « raison-monde néolibérale » (Pierre Dardot et Christian Laval) tente de pervertir les concepts politiques et économiques.
La définition de la démocratie libérale est associée à la notion d’égalité politique. Elle veut que chaque citoyen dispose d’une capacité égale à prendre part à l’exercice du pouvoir. Dans les faits, les citoyens ordinaires ont très peu de chance de concrétiser l’idéal de la souveraineté populaire. La capacité de déterminer collectivement les lois et les règles est abandonnée entre les mains de professionnels de la politique. Ce qui en soi, comme le disait Cornelius Castoriadis, tourne en ridicule l’idée même de démocratie.
Il n’est donc pas question d’éprouver une nostalgie quelconque à propos d’un prétendu âge d’or de la démocratie qui aurait couru entre la seconde guerre mondiale et le début des années 1970. 1973, année du coup d’État militaire contre le président socialiste chilien Salvador Allende, est une date un peu arbitraire, mais non dépourvue de force symbolique, pour marquer le début de l’offensive politique néolibérale.
Le néolibéralisme est souvent interprété comme une aggravation du régime de la démocratie libérale. La passivité des citoyens s’intensifierait du fait de leur renvoi aux seuls statuts de consommateurs ou d’électeurs. Wendy Brown envisage les choses différemment et pointe une mutation qualitative.
Dans le régime dit de la démocratie libérale, l’égalité ou la liberté de participation aux décisions concernant l’avenir de la nation était une promesse. Elle entretenait l’idée que le champ économique du capitalisme demeurait séparé du champ politique de la démocratie, dans lequel tout citoyen pouvait exprimer son opinion.
Le néolibéralisme comme projet de soumission de tous les domaines de la vie humaine à la logique économique ne peut que s’attaquer à des idées qui visent à circonscrire le champs d’intervention du marché. En somme, le projet néolibéral qu’Angela Merkel aime à rappeler est celui de la démocratie s’adaptant au marché. Alors que le projet véritablement démocratique soutient que le marché doit s’adapter à la démocratie.
Voir notre article La Démocratie ou la Dette?
Quand on ramène toutes choses à la dimension économique, il n’y a plus aucune place pour les notions de démocratie, de souveraineté populaire ou de justice politique. Comme le souligne Wolgang Streeck, il est hors de question de parler de démocratie, dès lors qu’un État donne priorité aux intérêts des détenteurs de la dette publique ou au critères comptables d’un Pacte budgétaire, plutôt qu’aux demandes des citoyens.
Dans l’optique néolibérale, la liberté individuelle trouve son terrain d’application sur les marchés, sous la forme des prétendues préférences des consommateurs. En réalité, la liberté qui est la mieux préservée est la liberté des propriétaires du capital, à investir et à désinvestir comme bon leur semble. Peu importe, si finalement, cette liberté entrave celle d’un grand nombre de gens à vivre décemment de leur travail, à consommer des produits sains ou encore à respirer un air non toxique.
Finalement, dans la pensée néolibérale, « liberté » signifie droit à rivaliser économiquement. « Égalité » signifie droit à s’insérer dans le champ de la compétition économique (le marché) qui est par nature inégal. Le néolibéralisme non seulement intensifie les inégalités sociales que le capitalisme a toujours générées. Mais en plus, il les légitime en tant qu’expression de la justice.
Cette justification des inégalités peut être illustrée par la fable de la cigale et des fourmis. Nous vivons tous dans une immense prairie (le « marché libre ») dans laquelle chacun peut ramasser autant de graines qu’il le souhaite, dans la mesure où il veut bien s’en donner la peine. Ceux qui en amassent le plus sont les plus méritants. La richesse sanctionne les efforts des premiers de cordées.
L’autre conversion magique opérée par les néolibéraux concerne la légitimation de la réduction de la liberté et de l’expression politique au nom de la sécurité et du maintien de l’ordre. Ce tour de passe-passe est nécessaire pour tenter de masquer une réalité objective. Dans la mesure où les gouvernements donnent la priorité au respect d’objectifs budgétaires, d’ajustement structurel ou de consolidation de leur dette, ils ne peuvent réagir qu’autoritairement, à l’encontre des mouvements sociaux que suscitent les conséquences sociales et écologiques de leurs politiques.
Il est de mode de faire référence au roman 1984 de Georges Orwell pour dénoncer la surveillance et la manipulation des masses, grâce aux nouvelles technologies (internet, téléphones cellulaires, reconnaissance de visage…). Mais au regard de l’analyse de Wendy Brown, on pourrait penser que l’apport majeur du livre, pour la compréhension de notre temps, concerne la notion de doublepensée.
Le procédé a pour objectif d’annihiler toute forme d’esprit critique, en faisant accepter simultanément comme vraies deux idées contradictoires.
C’est ainsi que, dans 1984, le Parti unique use des trois slogans suivants : la guerre c’est la paix ; la liberté c’est l’esclavage ; l’ignorance c’est la force. Les idéologues, les dirigeants politiques, les médias néolibéraux usent eux aussi de la doublepensée. Ce serait déjà faire œuvre utile que d’en dénoncer chaque jour l’inventaire: l’inégalité c’est la justice ; la compétition c’est l’égalité; l’interdiction de manifester c’est la liberté ; la répression c’est la sécurité ; l’état terroriste (qui gouverne par la terreur) c’est l’état de droit …
Gilles Sarter