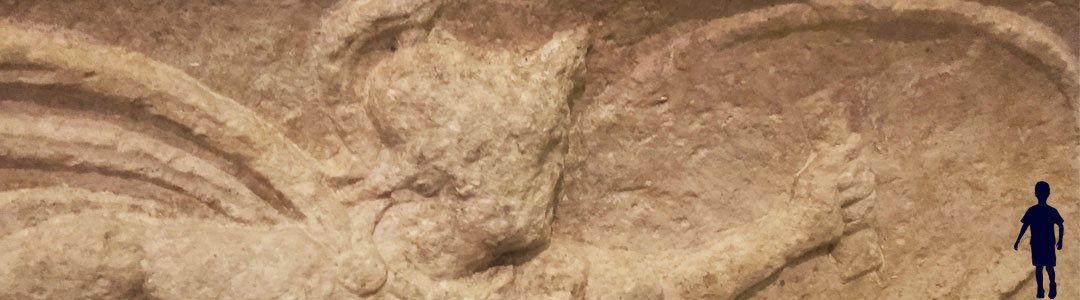Lorsqu’on nous demande de donner des exemples d’institutions ou de phénomènes sociaux, tout un ensemble de réalités peut nous venir rapidement à l’esprit : le langage, les lois, les valeurs, les traditions… En revanche, peut-être que nous ne pensons pas spontanément aux modalités d’expression des sentiments (larmes, cris, gesticulations…). Pourtant, ces dernières appartiennent aussi à la catégorie des faits sociaux.
L’expression du chagrin
Marcel Mauss démontre à partir de l’exemple des rituels funéraires australiens que différentes manières d’exprimer les sentiments (cris, larmes, gesticulations…) sont fondamentalement des faits sociaux. A ce titre, elles ne sont pas spontanées mais imposées, formalisées et régulées.
Dans les populations autochtones d’Australie, les cultes des morts étaient très élaborés. Outre les chants ou les lamentations collectives, ils pouvaient inclure des séances de spiritisme et de conversation avec les défunts. Ces cérémonies étaient publiques, bien réglées et communautaires. A ce titre, les participants n’appartenaient pas seulement au campement du mort mais aussi aux communautés plus élargies (tribu, fraction de tribu).
Les rites les plus simples qui prenaient l’allure de cris ou de chants n’étaient pas aussi collectifs. Toutefois, nous allons voir qu’ils dépassaient tout-à-fait le cadre restreint de l’expression de sentiments individuels et spontanés.
Tout d’abord, c’était généralement à des moments précis ou à des occasions bien déterminées que les femmes abandonnaient leurs occupations quotidiennes pour s’adonner à des hurlements, des chants ou des invectives, à l’encontre du responsable présumé du décès (la mort était généralement considérée comme résultant d’actes de sorcellerie).
Marcel Mauss, Essais de sociologie, Points
Par exemple, le « cri pour la mort » était généralisé dans la région du Queensland. Il durait aussi longtemps que l’intervalle séparant le premier et le second enterrement du défunt. A des heures précises, notamment juste avant le coucher et le lever du soleil, tous les membres du campement hurlaient et pleuraient. Après ces manifestations ostentatoires, le camp reprenait son train-train habituel.
Parfois, plusieurs campements ayant des morts se rencontraient à l’occasion de foires, de regroupements pour la cueillette de noix ou pour des cérémonies d’initiation.
Ces rassemblements donnaient lieu à de véritables concours de lamentations.
Qui doit s’exprimer?
Ce n’étaient pas uniquement les moments ou les circonstances d’expression des peines et chagrins qui étaient fixés mais aussi les catégories d’individus obligés de le faire.
Généralement, il ne s’agissait pas des parentés de fait comme les pères, les fils ou les sœurs d’un même père… En revanche, les parentés de droit, les cognats, les simples alliés devaient manifester un maximum de chagrin. Chez les Warramunga, les beaux-frères hurlaient en recevant les biens du mort.
Le plus souvent, l’obligation d’exprimer du chagrin ou de la colère était dévolue aux femmes bien que le déroulement des cultes religieux était généralement réservé aux hommes.
Pourquoi les rituels funéraires appartenaient-ils aux femmes ? Peut-être parce ces dernières étaient considérées comme plus spécialement en relation avec les puissances malignes. Elles étaient souvent tenues pour être plus ou moins responsables de la mort de leurs maris. Par ailleurs, il était souvent interdit à l’homme de crier quel que soit le prétexte et en particulier la douleur.
Comme nous l’avons déjà dit, parmi les femmes ce n’étaient pas celles qui entretenaient des relations de parenté biologique avec le défunt (fille, sœur en descendance masculine,…) qui devaient pleurer mais celles déterminées par des relations de droit, comme « les » mères et « les » sœurs en général (les campements fonctionnaient en parenté par groupes) et la veuve du mort.
Les femmes en charge des lamentations et des pleurs se soumettaient aussi à des mortifications cruelles qui entretenaient leurs douleurs et leurs cris.
Ces macérations n’excluaient nullement la sincérité des sentiments de chagrin et de colère exprimés.
Expressions symboliques
A tous les éléments conventionnels évoqués (définition des catégories de personnes concernées, moments et modalités d’expression), il faut ajouter la nature et le contenu des lamentations.
L’expression des sentiments était toujours à quelque degré musicale. A minima, elles étaient rythmées et poussées à l’unisson. Mais parfois, elles prenaient la forme de refrains, de chants ou de chœurs alternés.
Cette musicalité témoigne assez l’origine sociale des formes de manifestation de chagrin. Mais même lorsqu’elles se limitaient à des cris collectifs, elles acquéraient de ce fait une efficacité d’expulsion du maléfice.
Finalement, l’expression des sentiments de chagrin, de colère et de peur liée à la mort était tout-à-fait régulée et conventionnelle, chez les Australiens. Les modalités et les moments d’expression ainsi que les catégories de personnes concernées étaient définies socialement. Toutefois, ce caractère social n’enlevait rien à l’intensité, à la violence et au naturel des sentiments.
Mais de ce fait, ces manifestations sentimentales étaient bien plus que personnelles, elles devenaient symboliques.
Les personnes qui étaient obligées de les manifester les manifestaient certes pour elles-mêmes mais aussi pour le compte des autres, sous une forme d’expression comprise par les autres.
L’expression du chagrin et de la colère lors du deuil était une manière de sentir et d’agir élaborée socialement. C’est dire qu’elle s’imposait aux individus qu’ils le veuillent ou non.
Découvrez d’autres articles d’ethnologie
Qui doit et ne doit pas manifester son chagrin, sa peur, sa colère, sa frustration…? Selon quelles modalités et quelle intensité? A quels moments, dans quelles situations, en présence de qui? Pour comprendre les sentiments on ne peut se limiter à l’examen de leurs dimensions physiologiques et psychiques.
En accord avec l’enseignement de Marcel Mauss et d’Émile Durkheim, ils doivent aussi être abordés comme des faits sociaux.
© Gilles Sarter