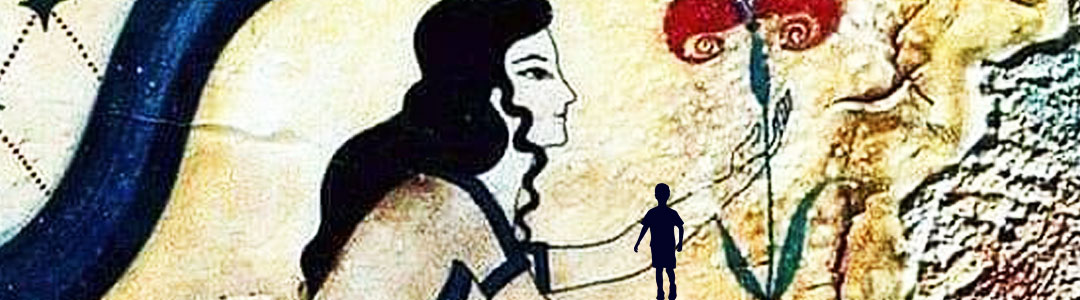La théorie de la reproduction contradictoire des rapports capitalistes de classe forme, selon Michael Burawoy et Erik Olin Wright le cœur du marxisme sociologique. Quel est le contenu de cette théorie ?
1- Rapport d’exploitation et classes sociales
Pour commencer, la notion de rapport d’exploitation est au centre de la théorie de la reproduction contradictoire des rapports capitalistes de classe.
Lire un article sur le rapport d’exploitation
Dans le mode de production capitaliste, le rapport d’exploitation se concrétise par le fait que la plupart des gens sont exclus de la possession des moyens de production. De ce fait, ils n’ont pas d’autre possibilité, pour subsister, que de vendre leur force de travail. Quant aux propriétaires des moyens de production, ils prospèrent en s’appropriant la part de valeur qui est produite par le travail de leurs employés et qui excède la rémunération de ces derniers.
Autrement dit le rapport d’exploitation repose sur trois principes : (1) l’exclusion ; la masse des gens est tenue à l’écart de la propriété des moyens nécessaires à leur propre reproduction ; (2) l’appropriation de l’effort d’autrui ; les capitalistes s’emparent d’une part de la valeur produite par les travailleurs ; (3) l’interdépendance inverse de la prospérité ; les capitalistes s’enrichissent parce que les travailleurs s’appauvrissent.
La référence au rapport d’exploitation permet de définir les classes sociales selon une approche relationnelle. Aux deux positions antagonistes déterminées par ce rapport (exploité/exploiteur) correspondent deux positions de classe principales, celle des travailleurs et celle des capitalistes.
A partir de ces éléments, la thèse de la reproduction contradictoire des rapports de classe se déploie en trois « sous-thèses » : 1) thèse de la reproduction sociale des rapports de classe, 2) thèse des contradictions du capitalisme, 3) thèse de la crise et du renouvellement institutionnel.
2- Reproduction sociale des rapports de classe
La structuration de la société en classes, c’est-à-dire sa structuration selon un rapport d’exploitation, est instable. Elle nécessite en permanence d’être reproduite. Cette nécessité de reproduire les rapports sociaux n’est pas spécifique au rapport d’exploitation. Elle s’applique à tous types de rapports (patriarcat, racisme, servage, esclavage…).
Les rapports sociaux quels qu’ils soient ne se perpétuent pas par simple inertie. Leur perpétuation est assurée par la mise en œuvre de dispositifs institutionnels adéquats.
Les institutions qui permettent de reproduire les rapports sociaux agissent à l’échelle des relations entre individus. Ce sont les représentations, les normes, les manières de se conduire ou de se tenir… qui orientent et encadrent les interactions quotidiennes, notamment dans le procès de travail.
Lire un article sur les institutions sociales
A l’échelle de la société, les institutions prennent la forme d’appareils (État, école, médias, police, armée, partis politiques, institutions politiques…) qui participent à la reproduction des rapports de classe.
3- Contradictions du capitalisme
La reproduction des rapports sociaux, quelle que soit leur nature, est problématique parce que les dispositifs institutionnels peuvent être l’objet de contestation. Le mode de production capitaliste rencontre dans sa reproduction une catégorie particulière de problèmes liée au fait que ce mode repose sur un rapport d’exploitation.
Comme nous l’avons vu, le rapport d’exploitation implique que la classe exploitée subit des préjudices, au profit des exploiteurs. Les travailleurs tendent donc à modifier ce rapport. La reproduction du capitalisme doit faire face à des formes actives de contestation et de résistance.
Dans un rapport d’oppression, l’oppresseur peut se permettre d’éliminer physiquement les opprimés. En revanche, l’exploiteur n’a pas cette latitude, dans la mesure ou sa prospérité matérielle dépend des exploités.
Le rapport capitaliste repose sur l’appropriation de l’effort d’autrui. Il confère donc une forme de pouvoir aux exploités. Par sa nature même le rapport capitaliste est explosif.
A la contestation s’ajoute une autre contradiction interne au capitalisme. Son développement permanent remet continuellement en cause les dispositifs institutionnels qui sont fonctionnels à un stade donné de ce développement. Les technologies, les procès de travail, les structures de classe, les marchés des matières premières en évoluant érodent à chaque fois l’efficacité des institutions et rendent nécessaire l’invention de nouvelles solutions institutionnelles. C’est ainsi qu’au capitalisme manchestérien a succédé le fordisme, puis au fordisme le néolibéralisme.
Les effets conjugués du développement du capitalisme et des contestations finissent donc par engendrer des situations de crise institutionnelle.
4- Crises et renouvellements institutionnels
Comme la reproduction sociale des rapports de classe nécessite des institutions fonctionnelles et comme les institutions ont tendance à être érodées, elles doivent se renouveler périodiquement.
Ces renouvellements ont lieu à l’occasion de crises institutionnelles. Dans ces occasions, les acteurs sociaux organisés considèrent que les institutions existantes ne sont plus en mesure de contenir les conflits sociaux dans des limites tolérables.
Les nouveaux dispositifs qui s’imposent à l’issue des crises ont tendance à conforter les intérêts fondamentaux de la classe capitaliste. Mais leur résolution n’est pas toujours optimale pour cette dernière.
Quoiqu’il advienne, les solutions institutionnelles qui sont trouvées n’éliminent pas le potentiel de résistance collective mais tentent de contenir cette dernière dans des limites acceptables par les agents sociaux.
Michael Burawoy et Erik Olin Wright, Pour un marxisme sociologique, Editions Sociales
Selon Michael Burawoy et Erik Olin Wright, la préoccupation centrale de l’exploration sociologique marxiste est de comprendre les obstacles et les opportunités pour un changement égalitaire et émancipateur des rapports sociaux. Concrètement, cela implique pour le marxisme sociologique de s’intéresser à la manière dont la reproduction sociale des rapports capitalistes est contradictoire et contestée.
Gilles Sarter