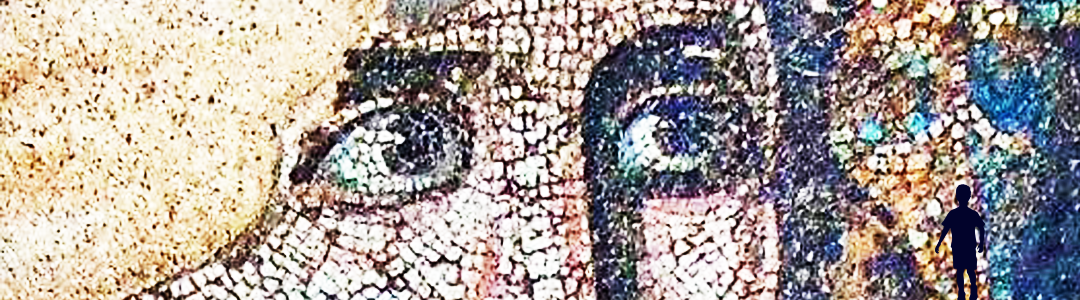L’autogestion est un mode d’organisation élémentaire de la société autonome et démocratique. Qu’est-ce que cela veut dire ? La société autonome est la société qui se reconnaît elle-même comme source et origine de ses lois. La démocratie c’est le régime social de l’autonomie, l’activité collective et réfléchie, par laquelle tous les participants à la société décident de son institution. L’autogestion c’est le mode d’organisation par lequel ceux qui accomplissent une activité décident collectivement ce qu’ils ont à faire et comment le faire.
La société hiérarchisée
Dans nos sociétés capitalistes bureaucratiques, le mode d’organisation hiérarchique est quasiment généralisé dans les différentes sphères de l’activité sociale : économie, politique (administrations locales et étatiques), monde associatif (partis, syndicats, clubs, fondations), etc.
Qu’est-ce que la hiérarchie signifie socialement ? Une couche de la population en dirige une autre qui ne fait qu’exécuter les décisions de la première.
Généralement, dans le cadre des activités salariées, la hiérarchie du commandement coïncide avec une hiérarchie des salaires. Les couches qui perçoivent les plus gros salaires profitent donc davantage du travail de la société que les autres couches.
Hiérarchies du commandement et des salaires sont si bien instituées que beaucoup de gens peuvent difficilement s’imaginer qu’il pourrait en être autrement. De la même manière, ils imaginent difficilement qu’ils pourraient eux-mêmes se définir autrement que par leur position sur l’échelle hiérarchique.
L’autogestion et la décision collective
Dans une organisation autogérée, les décisions ne sont pas prises par une couche dominante mais par l’ensemble des femmes et des hommes qui sont concernés par l’objet de ces décisions. L’autogestion est donc un système où ceux qui accomplissent une activité décident collectivement ce qu’ils ont à faire et comment le faire. Elle réunie les fonctions de direction et d’exécution.
Sur le plan social, une unité collective autogérée n’admet comme limites à ses propres décisions que celles tracées par sa coexistence avec d’autres unités collectives.
Par exemple, les décisions qui concernent un atelier sont prises par les travailleuses et travailleurs de cette unité. Mais les décisions qui engagent ou qui concernent plusieurs ateliers à la fois au sein d’une entreprise sont prises par l’ensemble des travailleuses et travailleurs de l’entreprise, etc. Les décisions qui engagent les consommateurs, les usagers et les habitants sont prises en concertation avec eux.
Sur le plan écologique, une unité autogérée pose à ses décisions des limites qu’elle trace à la lumière de la compréhension de ses interactions avec l’environnement naturel.
La coordination et la délégation
Dans l’autogestion, décider signifie bel et bien décider par soi-même. Bien sûr, dans une foule de cas, l’existence de structures de concertation et de coordination entre unités collectives nécessite la désignation de représentants ou de délégués. Par exemple, la désignation de représentants d’ateliers pour leur coordination au sein de l’entreprise ou la désignation de représentants des entreprises pour la coordination dans la branche industrielle…
Toutefois, la désignation de délégués n’est compatible avec l’autogestion que si ces derniers représentent vraiment la collectivité dont ils sont issus. Il n’est donc pas question de désigner des gens qui vont décider, pendant une période déterminée. Des électeurs qui élisent tous les cinq ans un « représentant » irrévocable aliènent, pendant ces cinq années, leur pouvoir de décision à un individu qui, pour cette raison même, ne peut être considéré comme leur représentant.
L’autogestion implique que les délégués restent soumis au pouvoir collectif. Ce qui signifie que celui-ci les révoque chaque fois qu’il le juge nécessaire.
L’accès à l’information et la place des spécialistes
La prétention d’une minorité à posséder le monopole des informations nécessaires et à définir les critères de décision est une caractéristique des organisations hiérarchiques. Elles tendent en permanence à reproduire cette dissymétrie parce que les informations y montent de la base au sommet et n’en redescendent pas.
L’organisation hiérarchique est parfois justifiée par l’idée que les fonctions de direction ou de décision doivent être réservées à « ceux qui savent » ou à « ceux qui sont compétents », aux « experts » ou aux « spécialistes ». Dans ce système, les spécialistes habilités à diriger sont nombreux dans leurs domaines respectifs : spécialistes du management, de l’économie, de la gestion, de la politique, des sciences et techniques, de la guerre, etc.
Les principes de l’autogestion n’entrent pas en contradiction avec l’idée selon laquelle, les savoirs, les compétences, les domaines de l’expertise sont par définition spécialisés et qu’ils le deviennent davantage chaque jour.
En revanche, l’autogestion récuse totalement l’idée selon laquelle les « experts » ou les « spécialistes » sont les mieux placés pour diriger une collectivité.
Sorti de son domaine de savoir, un « expert » n’est pas plus capable de prendre une bonne décision qu’un non-spécialiste. De plus, les conditions ou les processus réels d’activité ne sont jamais mieux connus que par les intéressés eux-mêmes.
Les savoirs et les expertises ne peuvent être utilisés de manière optimale que si leurs détenteurs sont plongés au sein des collectivités de travail. L’autogestion nécessite une coopération étroite entre les « spécialistes » et ceux qui assument le travail au sens strict. L’autogestion est incompatible avec la séparation entre les catégories d’acteurs.
La contrainte et la discipline
Un argument en faveur de l’autogestion est que la hiérarchisation de toutes les activités sociales est à la fois le résultat et la cause du conflit qui déchire la société.
En effet, une des fonctions les plus importantes de la hiérarchie est d’imposer la contrainte. Cette nécessité provient du fait que les strates subordonnées ne manifestent pas en général un enthousiasme spontané pour faire ce que les strates dirigeantes veulent qu’elles fassent.
Dans le mode capitaliste, la résistance des travailleuses et des travailleurs provient de ce qu’ils peuvent se sentir exploités et aliénés. Ni leur travail, ni le produit de leur travail ne leur appartiennent. Ils ne décident pas eux-mêmes ce qu’ils ont à faire, comment le faire, ce qu’il advient de ce qu’ils ont fait et des profits tirés de leur travail.
La légitimation de la hiérarchie présente celle-ci comme « nécessaire », pour régler les conflits entre individus ou entre groupes.
En réalité, la hiérarchie est, à la fois, la source d’un conflit permanent entre exécutants et dirigeants et le résultat d’un conflit non moins permanent généré par le fait élémentaire qu’une minorité se réserve le droit de propriété et le droit d’usage des moyens de production.
Autrement dit, la question de fond n’est pas celle du minimum de discipline ou de contrainte qui est toujours requis dans le cadre d’une action collective. La question de fond est celle de qui décide et contrôle cette discipline et à quelle fin. Moins les gens sont associés à l’élaboration des règles collectives moins ils sont enclins à les suivre et plus il y a besoin de les contraindre.
Dans tous les groupes qui s’organisent autour d’une activité commune surgissent des règles de comportement et une pression collective qui les fait respecter. Un groupe autogéré est un groupe dont les membres décident eux-mêmes de leur discipline et éventuellement des sanctions à l’encontre de ceux qui ne la respectent pas.
Le « management » capitaliste sait comment instrumentaliser certains avantages de l’autogestion et comment s’en prévaloir. Par exemple, dans le « management par projet », les unités bénéficient d’une liberté relative dans leur organisation et dans le choix des moyens pour atteindre des objectifs donnés. La duperie réside bien sûr dans le fait que ces objectifs ne sont pas déterminés par les intéressés. Plus fondamentalement, les possibilités d’action des travailleurs et travailleuses sont toujours contraintes par l’impératif de maximisation du « produit » et de minimisation des « coûts ».
La pseudo-rationalité du capitalisme
Aucune organisation d’une chaîne de fabrication, aucun service ou politique publics ne peut être considéré comme rationnel ou acceptable, si il a été décidé sans tenir compte du point de vue de ceux qui y travailleront.
Il y a pléthore de situations dans lesquelles la continuation de la production d’objets ou de services ne tient que parce que les travailleurs s’organisent entre eux, en transgressant les procédures « officielles » sur l’organisation du travail.
Ce n’est pas parce qu’on suppose qu’une forme d’organisation ou des décisions sont « rationnelles » du point de vue étroit de l’efficacité productive ou de la minimisation du ratio coût/produit qu’elles sont rationnelles en général.
Ces décisions doivent au contraire être considérées comme irrationnelles si elles tendent à subordonner complètement les travailleuses au processus de fabrication et à les traiter comme des pièces du mécanisme productif. De la même manière doivent être considérées comme irrationnelles les règles de fonctionnement des services publics qui rêvent de rentabiliser les besoins élémentaires des populations.
Cette irrationalité résulte précisément du fait que les décisions sont prises par d’autres que ceux qui doivent les mettre en application.
L’autogestion ne suit pas cette pseudo-rationalité. Sa logique est toute autre. Les collectivités de travailleurs peuvent très bien décider pour elles et en concertation avec les consommateurs, usagers, habitants ce qui vaut la peine d’être produit et comment le produire, ce qui vaut la peine d’être aménagé et comment, ce qui vaut la peine d’être enseigné à l’école, ce qui vaut la peine d’être préservé dans les paysages, la faune et la flore naturelles, etc.
Le domaine d’application des principes de l’autogestion est donc plus vaste que celui des activités de production. L’autogestion comprise comme domination consciente des êtres humains sur l’ensemble de leurs activités sociales est la mise en application des principes de l’autonomie et de la démocratie. Elle est la traduction en action de l’hypothèse selon laquelle rien n’est indiscutable. Il n’existe pas de règle et de modèle absolus. Ils sont toujours le fruit de l’imagination, de l’expérimentation et de la délibération.
Gilles Sarter
Lire aussi:
-> Le projet d’autonomie individuelle et collective