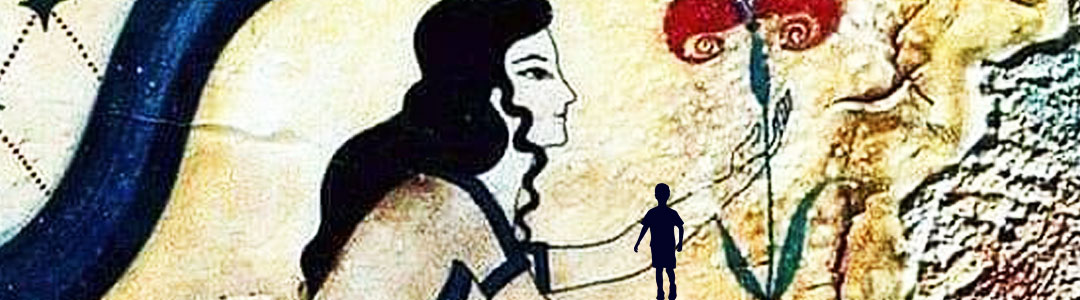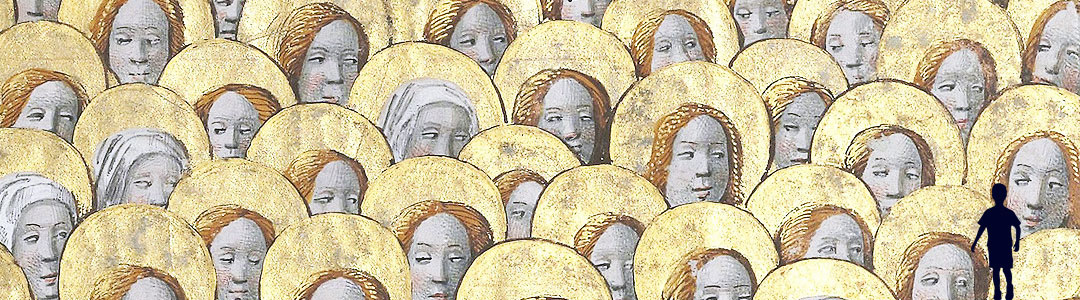Nous avons vu, dans deux articles précédents, que le profil de l’individu étayé par la propriété privée et la propriété sociale est, selon Robert Castel, majoritaire dans notre société. Toutefois, après cinq décennies de capitalisme néolibéral, la dynamique qui portait la propriété sociale et avec elle, la citoyenneté sociale, semble brisée.
Dès lors, R. Castel fait l’hypothèse de l’émergence et du développement de deux autres profils d’individus qu’il qualifie d’ « individus par excès » et d’ « individus par défaut ». Dans cet article, nous voyons ce qu’est un « individu par excès » et les problèmes liés à l’analyse de son expansion dans notre société.
Libérer et améliorer l’individu
Selon la qualification employée par Marcel Gauchet, l’ « individu hypermoderne » aurait pour particularité d’être le premier individu pouvant se permettre, en raison de l’évolution sociale, d’ignorer qu’il vit en société.
Robert Castel, La montée des incertitudes, Seuil, 2009
C’est au début des années 1970 que R. Castel pense observer les premières manifestations de ce type d’individus complètement immergés dans leur subjectivité, au point de se détacher de tout autre investissement.
Aux États-Unis, le sociologue réalise des enquêtes par immersion, au sein de la mouvance des encounter groups. Il s’agit de petits groupes de personnes qui se réunissent, sous la conduite d’animateurs expérimentés.
Un préjugé partagé au sein de cette mouvance est que l’individu en société est toujours bridé dans l’expression de ses pleines potentialités. Il lui faut donc effectuer un travail sur lui-même pour élargir ses capacités comportementales et psychiques.
A cette fin, différentes techniques sont mobilisées (gestalt-thérapie, cri primal, analyse transactionnelle, counselling…). Elles prétendent se substituer à la psychanalyse considérée comme trop longue et trop intellectuelle. L’analyse manquerait l’objectif du travail sur soi qui est de libérer et d’améliorer l’individu ici et maintenant.
Une nouvelle culture psychologique
R. Castel compare ces groupes à des laboratoires, au sein desquels s’élabore la pointe avancée d’une « nouvelle culture psychologique ». Cette culture vide la société de ses déterminants objectifs. Elle ne s’intéresse qu’à la position de l’individu qui se prend lui-même pour seul objet et qui se donne pour seule fin de réaliser ses propres aspirations et de maximiser ses capacités.
Ces individus enfermés dans leur individualité et qui chassent le social sont désengagés de la société. C’est pourquoi le sociologue parle à leur sujet d’ « individus par excès ».
L’objectif de se réaliser en tant qu’individu dans une sorte de solipsisme conduit à la limite au narcissisme. Or le mythe de Narcisse nous rappelle que ce dernier peut conduire à la tragédie.
Au milieu du 19è siècle, le type initial de l’individu moderne était le « bourgeois propriétaire » qui était homme de la responsabilité et du devoir (patriotique, religieux, familial, d’accumulation matérielle…). Il était fortement impliqué dans l’accomplissement des différents rôles sociaux qui leur étaient afférents.
Lire aussi « Fatigue de soi ou Société de la Fatigue?«
A l’opposé, la conception du bonheur que l’individu narcissique poursuit éperdument est un impossible accomplissement de lui-même et par lui-même qui, selon Alain Ehrenberg, finit par l’installer dans une « fatigue de soi ».
L’expansion de l’ « individu par excès »
Dans les années 2000, R. Castel persiste dans son analyse. Mais il souligne que la compréhension de l’expansion du profil de l’ « individu par excès » pose des problèmes difficiles. L’identification de ses conditions objectives, dans la société contemporaine, n’est pas aisée. Le sociologue signale cependant quelques pistes de recherche.
Reprenant l’argument de Tocqueville, R. Castel avance, tout d’abord, que dans certains secteurs de la société démocratique, les individus peuvent croire n’avoir besoin de personne.
Ces individus évolueraient dans une sorte de « vide social », étant non cadrés par des régulations collectives et non conduits par des aspirations collectives.
Il s’agit avant tout des agents qui pensent avoir en eux-mêmes les supports nécessaires pour assurer leur indépendance sociale. Ces supports sont constitués des différentes formes de capital, au sens de Pierre Bourdieu : capitaux économiques, symboliques, culturels…
L’ « individu par excès » serait donc, avant tout, pour R. Castel, l’individu qui accomplit une forme de désaffiliation sociale, de détachement des appartenances et des valeurs collectives « par le haut ». Expérimentant des conditions de vie confortables, dans lesquelles les interactions sociales ne paraissent plus poser de problèmes, il peut se retourner sur lui-même et se consacrer à sa propre exploration subjective.
Le capital humain
Mais ce schéma reste simplificateur. Une analyse plus approfondie de l’implantation et de la diffusion de ce type est nécessaire. En effet, R. Castel souligne, d’une part, qu’il existe des individus très bien pourvus dans les différentes formes de capitaux mais qui sont complètement affiliés au monde social. Ils s’y adonnent à la poursuite des richesses et des honneurs et ont une parfaite maîtrise des contraintes sociales qui y sont liées.
D’autre part, R. Castel remarque que le type de l’ « individu par excès » n’est pas seulement porté par les plus nantis.
Et à ce titre, il nous semble que le sociologue manque d’investiguer les supports objectifs que constituent les différents dispositifs mis en place par les politiques néolibérales (politiques d’éducation, du travail, de la finance…), par le management dans les entreprises et par le marketing, au cours des quatre ou cinq dernières décennies.
Sur ce sujet, voir Le Capital humain et l’entrepreneur de soi
Ces dispositifs poussent les individus à se constituer en entrepreneurs de soi. Ils orientent alors leurs comportements vers la recherche de la maximisation de leur capital humain, dans tous les secteurs et à toutes les étapes de leur vie (à l’école, à l’université, au travail, dans les loisirs et la consommation, dans les relations amicales et amoureuses…). Dès lors pour de nombreuses personnes, l’individualisation par excès serait le résultat d’un habitus incorporé, par inculcation explicite et implicite, plutôt que le fruit d’une démarche de désaffiliation « par le haut ».
Gilles Sarter
5/5