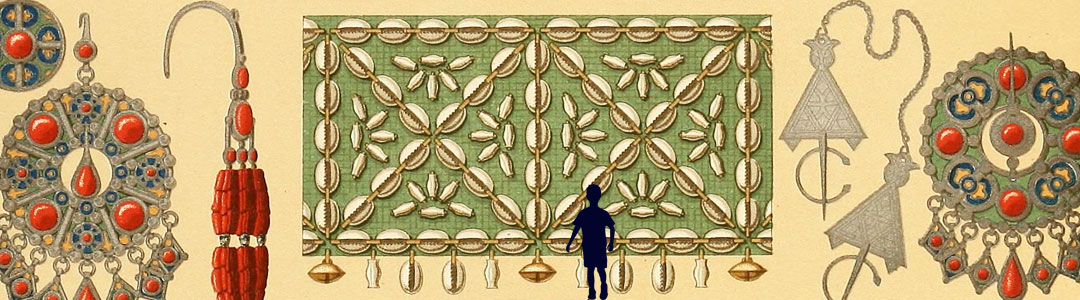Le concept d'habitus est central dans la sociologie de Pierre Bourdieu. Dans cet article, nous en détaillons les tenants. Puis, nous expliquons, comment la notion permet de rendre compte des articulations entre les comportements individuels et l'organisation des sociétés.
Comportements et régularité du monde social
Dans le documentaire La sociologie est un sport de combat, Pierre Bourdieu énonce de façon très simple la question qui fonde le projet sociologique :
Pourquoi les gens agissent-ils comme ils le font et avec une certaine régularité ?
Premièrement, cette question appelle une théorie explicative de l'action humaine, qui puisse rendre compte des relations entre société et individu.
Deuxièmement, le questionnement à propos de la régularité du monde social est au cœur de la réflexion du sociologue. Dans la Domination masculine, il avoue son étonnement devant la perpétuation des ordres établis, avec leurs rapports de domination et leurs injustices.
L'élaboration de la notion d'habitus a permis à Pierre Bourdieu d'investir ces deux problématiques.
Tendances et propensions à agir
Attribuer un habitus à une personne ou à une catégorie de personnes, c'est leur attribuer un système de dispositions à se comporter d'une certaine façon.
Dans une première approche, on pourrait dire qu'un habitus ressemble à ce que le langage commun appelle un trait de caractère. Comme, par exemple, l'ostentation, la discrétion, l'ascétisme ou l'hédonisme...
Une personne disposée à l'ostentation exprime une tendance à se comporter comme un "m'as-tu vu", dans les différents aspects de sa vie : dans ses goûts, sa manière de s'habiller ou de décorer sa maison, dans le choix de sa voiture, dans sa façon de parler, dans ses attitudes corporelles et ses tentatives d'être toujours au centre de l'attention...
La propension ne dit pas qu'à coup sûr, l'individu concerné agira de manière ostentatoire. Mais il y a de fortes chances que cela se produise.
Par ailleurs, une tendance ne détermine pas les actes dans leurs modalités concrètes d'expression. On ne peut prédire exactement ce que le "m'as-tu vu" va faire ou dire, dans une situation donnée. On peut, tout au plus, parier sur le style de comportement qu'il va adopter.
Du social incorporé
L'habitus, à la différence du trait de personnalité, trouve son origine dans le social. Il n'est pas l'apanage d'un individu. Au contraire, il est partagé par un groupe social bien délimité.
L'un des exemples les plus connus, parmi ceux décrits par Bourdieu, est le sens de l'honneur. Dans les communautés villageoises kabyles, cet habitus pré-dispose les gens à se comporter, dans toutes les situations, en femme ou en homme d'honneur.
Pierre Bourdieu écrit que si cet habitus pouvait être condensé en une seule formule ce serait : "Faire face !"
L'injonction s'applique à la posture corporelle : faire face à son interlocuteur, le regarder à la face, parler sans murmurer. Elle concerne les adversités de tous ordres (humaines, matérielles, naturelles) devant lesquelles il ne faut pas reculer. Cet habitus commande encore de faire face à l'hôte en lui témoignant l'hospitalité ou de se montrer généreux, etc.
Dans ce contexte, le sens de l'honneur est partagé par tous les membres de la communauté. Et ces derniers sont prompts à sanctionner les conduites qui s'en écartent.
Si la genèse d'un trait de personnalité relève d'une histoire individuelle. L'origine d'un habitus, au contraire, doit être recherchée dans les particularités de l'histoire collective.
L'habitus, dit encore Pierre Bourdieu, c'est du "social incorporé" ou du "social fait corps".
L'habitus, du verbe habeo (avoir), c'est ce qui a été acquis.

Sociétés modernes et classes sociales
Pierre Bourdieu a élaboré la notion d'habitus, dans le cadre de communautés villageoises. Ces dernières sont caractérisées par une relative homogénéité des conditions matérielles et culturelles d'existence. Les gens y sont façonnés par un contexte de socialisation cohérent.
Qu'en est-il dans les sociétés modernes et différenciées ?
Le sociologue appréhende la société française comme étant structurée en classes.
Une classe sociale correspond à un ensemble de personnes qui partagent des conditions d'existence proches.
Deux grands principes établissent une différenciation entre les conditions de vie des agents sociaux. Il s'agit du capital économique (l'ensemble des propriétés financières, mobilières, immobilières) et du capital culturel (niveau scolaire, diplômes, connaissances langagières et culturelles...), détenus par les individus ou les familles.
D'une part, la classe composée de détenteurs d'un fort volume de capital global (capital économique + capital culturel), comme les patrons d'entreprises, les hauts-fonctionnaires, les médecins, les cadres supérieurs... se distingue de celle des plus démunis, ouvriers agricoles et employés sans qualification.
D'autre part, une différenciation opère selon la structure du capital. Les artistes, les professeurs d'université sont plus riches relativement, en capital culturel qu'en capital économique. En revanche, les patrons d'entreprises possèdent relativement plus de capital économique que de capital culturel. De la même façon, à un niveau inférieur de la hiérarchie sociale, les instituteurs s'opposent aux petits commerçants...
A ces différentes positions sociales correspondent des contextes de vie et de socialisation, plus ou moins spécifiques qui engendrent des habitus distincts.
Goûts de classes
Les habitus de classe s'actualisent différemment. Les biens consommés, les activités pratiquées (sports, loisirs...), les lieux habités et fréquentés (commerces, écoles...), les opinions politiques, les manières de s'exprimer ou encore les postures corporelles diffèrent systématiquement, entre les hauts-fonctionnaires et les ouvriers...
Les habitus constituent les goûts. Ainsi, les agents appartenant aux différentes classes sociales opèrent des différences entre ce qui est bon/mauvais, bien/mal, distingué/vulgaire. Mais ces différenciations ne sont pas les mêmes.
Selon la classe d'appartenance, un même objet ou un même acte peut apparaître comme vulgaire, comme prétentieux ou comme distingué.
Finalement, il est important de garder à l'esprit le fait suivant. Quelle que soit la classe d'appartenance des gens, leur sens commun classe et hiérarchise les biens et les comportements: langage "populaire" ou "distingué" ; accordéon ou violon ; belote ou bridge, jeans ou "costard"...
Cette hiérarchisation ne résulte pas de la valeur en soi des objets ou des manières de faire. Elle provient du fait que les gens ont incorporé des dispositions à juger et à hiérarchiser d'une certaine façon.
Ces goûts sont le produit de conditions d'existence, qui sont elles-mêmes dépendantes du volume et de la structure du capital détenu.
Théorie de l'action
En élaborant la notion d'habitus, l'une des intentions de Pierre Bourdieu visait à échapper à deux erreurs.
La première tend à considérer les gens comme agissant mécaniquement, sous l'effet de contraintes externes (règles, structures, modèles...). La seconde les tient pour des sujets pleinement conscients qui agissent par des choix et des calculs rationnels (théorie de l'homo œconomicus et de son action rationnelle).
A l'inverse, le sociologue envisage les comportements comme étant issus de rencontres, entre des situations et des dispositions:
Situation + Habitus = Action
Sa théorie permet de prendre en compte les expériences de socialisation passées, sans omettre le rôle de la situation présente.
En effet, aucune de ces deux réalités ne peut être désignée comme le véritable déterminant des pratiques. La réalité d'une action est toujours relationnelle.

Sens pratique
L'habitus dotent les gens d'un sens pratique. C'est-à-dire du sens de ce qui est à faire, dans une situation donnée. La notion évoque ce qu'on appelle le sens du jeu, dans les sports collectifs notamment.
Les situations rencontrées par une personne peuvent être relativement similaires aux conditions de socialisation qui ont permis l'acquisition de son habitus. Dans ces circonstances, l'agent est comme un poisson dans l'eau. C'est le cas d'un paysan en Kabylie qui a grandi et vécu, au sein de sa communauté traditionnelle.
Ses structures mentales sont ajustées par anticipation aux événements qu'il affronte.
Il peut les évaluer sur-le-champ et y répondre, dans le feu de l'action. Il n'a pas besoin d'y réfléchir, comme s'il était placé face à un problème.
Le concept d'habitus n'exclut pas, pour autant, celui de stratégie.
Les individus peuvent élaborer des projets. Simplement, ils les établissent sur la base des appréciations et des perceptions permises par leurs habitus respectifs.
Ce mécanisme explique notamment les cas d'auto-censure. Une personne renonce à un objectif personnel, parce que son habitus l'envisage comme inapproprié : un jeune homme issu du milieu ouvrier renonce à entreprendre une carrière artistique, parce que son habitus lui fait envisager l'art comme étant le domaine réservé des classes bourgeoises...
Autrement dit, la théorie de l'action de Pierre Bourdieu admet la capacité inventive ou créatrice de l'individu. Mais, elle considère que cette inventivité est délimitée ou bornée par des pré-dispositions qui se constituent en goût, sens du jeu ou encore en espérance aux chances de réussite.
Désajustements
Les habitus des personnes ne sont donc pas toujours ajustés aux circonstances qu'ils rencontrent.
Cela se produit à chaque fois que la situation vécue par l'agent est différente du contexte qui a produit ses dispositions.
Ces cas de désajustements apparaissent lorsque des individus ou des collectivités entières sont transplantées, volontairement ou non, dans des contextes culturels différents : migrations, déportations, exils...
Sans être transplantés, les gens peuvent être amenés à fréquenter des univers sociaux différents voir contradictoires. On pensera à l'agriculteur qui doit évolué, à la fois, dans l'univers traditionnel de l'entre-soi villageois et dans l'univers de l'économie capitaliste qui enserre sa communauté.
Dans les sociétés modernes différenciées, les sujets connaissent souvent des ruptures biographiques. L'enfant qui entre à l'école, le jeune adulte qui rejoint le monde professionnel peuvent être confrontés à des univers sociaux dont les codes sont éloignés de ceux de leur milieu d'origine.
Sont aussi concernés tous les gens qui connaissent une "ascension" sociale ou, a contrario, un déclassement vers le "bas". Dans ces circonstances, ils sont contraints d'adopter des manières de s'exprimer, de se comporter, de penser auxquelles ils ne sont pas pré-disposés.
Ces décalages génèrent des tensions, voire des souffrances, psychiques et corporelles.

Stabilité des habitus
Bien sûr les habitus évoluent en fonction des nouvelles expériences. Mais Pierre Bourdieu avance que leur mode de fonctionnement tend à prévenir les changements radicaux.
En effet, les dispositions initiales opèrent des sélections, dans l'acquisition des nouvelles informations. Elles tendent à rejeter celles qui sont capables de mettre en question les informations accumulées préalablement.
Surtout, l'habitus défavorise l'exposition à des conditions propices au changement.
Comme les dispositions sont à l'origine du choix des personnes et des lieux susceptibles d'être fréquentés, les personnes évoluent généralement, dans des univers sociaux, relativement adaptés à leur habitus et peu déstabilisants.
Reproduction de l'ordre social
La relative stabilité des habitus et la relation qu'ils entretiennent avec les structures sociales objectives expliquent comment l'ordre social se perpétue.
A travers l'habitus, les structures du monde social sont présentes dans les catégories de pensée que les individus mettent en œuvre pour comprendre leur société.
Dans les villages kabyles, le sens de l'honneur est objectivé, "rendu palpable" : par la manière dont les relations entre hommes et femmes sont organisées ; par les expressions langagières ; par les postures corporelles ; par les pratiques et rituels, d'hospitalité, de vendetta, de générosité...
Dès l'enfance, dans ce contexte, les manières de penser sont structurées selon le sens de l'honneur. Et les comportements reproduisent les structures objectives qui conditionnent les mentalités.
Dans la société française, la structuration en classes sociales s'observe dans des réalités concrètes. Elle est rendue tangible : par la géographie des quartiers urbains ; par les différences entre établissements scolaires ou d'enseignements supérieurs ; par la nature des biens consommés (aliments, vêtements,...) ; par les activités de loisirs ; par la nature des relations qui prévalent entre les gens...
Cette différenciation objective trouve son pendant dans les habitus de classe. A leur tour ces goûts s'actualisent dans des préférences, des choix, des classements qui contribuent à perpétuer un monde structuré en classes sociales différenciées.
Le processus de naturalisation
Cette reproduction du monde social s'appuie sur ce que le sociologue appelle le processus de naturalisation.
Les porteurs d'un habitus ne sont pas conscients de ce que leurs manières d'agir ou de penser doivent aux conditions sociales objectives.
Ils vivent leurs goûts comme étant "naturels" ou comme allant de soi et non pas comme résultant de leurs conditions d'existence.
Finalement, une société est le produit des représentations que s'en font des femmes et des hommes. Mais ces représentations sont elles-mêmes le fruit des structures sociales pré-existantes.
Sans le savoir, la plupart du temps, les gens tendent à reproduire l'ordre social, qu'ils occupent une position de dominant ou de dominé, au sein de la société.
Possibilité de changement
L'explication "en boucle" de la relation de détermination, entre structures mentales et objectives, distille une forme de pessimisme.
L'esprit des gens est structuré de manière à reconnaître la légitimité de l'ordre dominant. Dès lors par leurs agissements, ils reproduisent la structuration objective de la société, selon le même ordre. Ce qui renforce encore leur habitus et leur position de dominé, etc.
S'il en est ainsi, comment peut-on gagner en liberté ? Et notamment comment peut-on envisager d'imposer un nouveau modèle de société, reposant sur moins de domination ?
Un premier enjeu concerne la prise de conscience du caractère arbitraire de tous les modèles d'organisation sociale. Là réside la vocation de la sociologie critique.
Toutefois, la simple prise de conscience, bien que nécessaire, n'est pas suffisante. La domination est soutenue par des habitus pré-réflexifs. Ces derniers, on l'a vu, sont peu impactés par les nouvelles informations.
Pour induire un changement, il faut donc, aussi, combattre les instruments sociaux qui permettent l'inscription des habitus dans les corps.
Il faut conjuguer le dévoilement de l'arbitraire de la domination, à l'action sur les structures sociales objectives.
Finalement, les perspectives de changement semblent résider, dans la multiplication des expériences et des contextes de vie, d'éducation et de socialisation qui valorisent les nouvelles valeurs et qui sont susceptibles de les inscrire, dans les corps, sous la forme de dispositions.
Gilles Sarter
1/5 -> Suivant